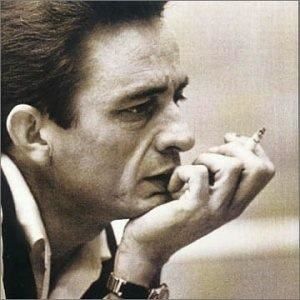"Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot."
Arthur Rimbaud. Une saison en enfer.
Kafka n'a pas franchement la réputation qu'il mérite. Les rares personnes à qui j'en ai parlé et qui l'ont lu (pour avoir été obligés de le faire au lycée) n'ont pas mesuré l'humour de cet auteur. En fait, on peut même dire qu'il les a copieusement fait chier. Pourtant, il suffit de lire L'Amérique, un roman inachevé, pour se rendre compte à quel point Kafka avait de l'humour. Attention, pas un humour à se tordre de rire, à se taper les mains sur les genoux, faut pas croire. Plutôt une sorte de rire diabolique, sadique, pervers mais qui finit invariablement par réellement me faire marrer. Comment ne pas rire en lisant les mésaventures de Joseph K. (qui partage bien plus que l'initiale de son nom avec l'auteur), pris au piège dans Le Procès ? Comment ne pas rire à le voir se battre comme un fou pour tenter de comprendre ce qui lui arrive ? Je dois avouer que la fin, surtout, m'a vraiment fait rire. Je devrais avoir honte, peut-être, ou me faire soigner car, nom d'un chien, il finit quand même égorgé comme une bête, dans un endroit sordide. Et pourtant, je n'ai pas pu retenir un rire, un peu malade, coupable, presque honteux. Finalement, ce Joseph K. finit par être tué, misérable petit être humain moyen, ni médiocre, ni génial. A cette petite chose, Kafka lui fait subir les pires supplices, sans pourtant avoir à toucher le moindre de ses cheveux (sauf à la fin bien entendu). Du sadisme pur et simple. Tout comme dans L'Amérique, d'ailleurs, dans lequel le jeune Karl Rossman n'a aucune prise sur son destin. Ses mésaventures sont désopilantes : il est ballotté par Kafka, qui le fait débarquer en Amérique, recueillir puis virer par son oncle, qui le jette sur les routes, seul. Ah on n'aimerait pas être à sa place ! Et pourtant qu'est-ce que je me marre ! Le voir subir les assauts sexuels d'une grosse en manque d'amour, c'est irrésisitible !
La Métamorphose, encore plus, me paraît un sommet d'humour noir. Gregor Samsa se réveille un matin transformé en cancrelat. Que faire ? Le pauvre est tellement pieds et poings liés à sa famille qu'il ne songe qu'à retourner au travail ! Cette nouvelle est d'une cruauté sans égale. La description de Gregor en cancrelat, avec ses petites pattes, à ramper misérablement, et la mère qui fait une crise de nerfs parce que son fils est un cancrelat, et le père qui le chasse à coups de canne dans sa chambre, ah tout ça est tellement drôle ! Pourquoi si peu de gens rient à la lecture de La Métamorphose ?
Finalement, le sadisme de Kafka est libérateur ; à chaque fois que je lis un de ses textes je me marre, je me dis que Joseph K. ou Gregor Samsa ou Karl Rossman c'est un peu nous, qui nous débattons pour pas grand chose. Que feriez-vous si demain matin vous vous réveilliez en cancrelat ? N'essayeriez-vous pas de joindre votre patron, d'expliquer que c'est momentané, que tout va rentrer dans l'ordre ? Et si une justice dont vous ignorez tout vous accuse sans prendre la peine de vous expliquer ce qu'elle vous reproche, jusqu'où ça vous mènerait les amis ? A toutes ces questions épineuses, Kafka répond, un sourire de possédé aux lèvres. Non, vraiment, il n'a pas la réputation qu'il mérite.