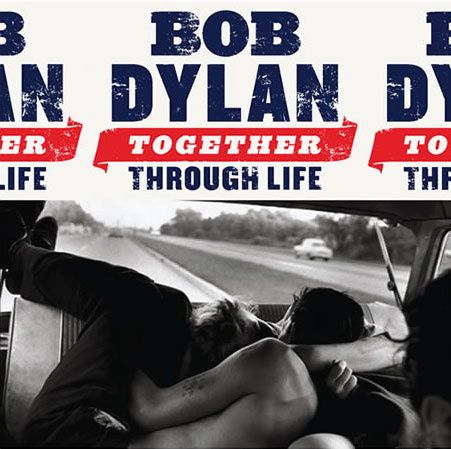Une décennie s'achève. Je n'ai pas le sentiment que ça fasse grand chose à qui que ce soit, alors que paradoxalement
Une décennie s'achève. Je n'ai pas le sentiment que ça fasse grand chose à qui que ce soit, alors que paradoxalement la propension à faire des tops, des bilans, des analyses, à mystifier et démystifier le passé est devenue endémique par chez nous. Peut-être est-ce parce que je m'intéresse de moins en moins au bruit ambiant, en tout cas c'est l'impression que j'ai.
En réalité, une décennie ne dure jamais vraiment dix ans, elle ne commence et ne s'arrête jamais aux bornes fixées par le calendrier. Pour moi elle commence à la sortie de
Pre millenium tension de Tricky, soit un an avant 2000. Disque qui n'a cessé de me hanter et que j'écoute régulièrement, dix ans après. Une musique qui est aussi un absolu, un point de non retour, qui n'allait embarquer personne dans son sillage, qui ne traçait aucune route. Après un album pareil, le grand revival, le grand recyclage pouvait commencer : les singes savants allaient débarquer avec la panoplie complète, ça aurait pu durer deux ans, ça fait dix ans que c'est installé. Plutôt que sauter dans le vide, demi-tour toute. Les 2000 n'auront pas eu leur trip hop. Finalement, je ne pense pas qu'elle soit achevée cette décennie. et Il faudra bien que quelqu'un débarque et fasse exploser ça, comme Tricky et sa borne
Pre millenium. Bon, j'ai probablement loupé le nouveau langage, sans doute, ce qui prouve juste que s'il est apparu, il n'aura pas eu l'écho du trip hop en son temps.
Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais réussi à faire la moindre liste, le moindre top (exception faite des "disques qui changent la vie" qui, de toute façon, ne constitue ni un classement, ni une liste). Je n'ai que des souvenirs épars, plus ou moins forts d'oeuvres qui m'ont accompagnées. D'immenses émotions au cinéma, des vrais chocs, des images qui restent en tête longtemps, qui laissent vaguement hébété à la sortie de la salle, dans le soir qui est tombé :
Lost in translation la fin, bien sûr, et l'effleurement de mains dans l'ascenseur,
Eternal sunshine pour les scènes de bonheur du couple,
Match point pour ce crescendo hallucinant, les
kill Bill, rien que l'enterrement d'Uma Thurman vivante, le début du
Nouveau monde de Malick qui est peut-être ce que j'ai vu de plus beau, une perfection,
Two lovers et le sein de Gwyneth Paltrow, les
Star wars II et III, indissociable d'une période de ma vie (Max si tu lis ça...), l'excitation incroyable que j'ai ressentie dans la file d'attente pour l'épisode II... Un truc de gosse. Le même que pour
Le seigneur des anneaux. Le trip de
Gerry, ces deux mecs qui se perdent dans le désert,
Brown bunny de Vincent Gallo, et Duris dans
De battre mon coeur s'est arrêté... J'aime chaque seconde de ces films. J'ai écumé les salles obscures, j'ai pesté contre les vf désastreuses, je me suis enquillé les films de super-héros, certains franchement mauvais, j'ai pas poussé le vice à me taper les films français avec Vincent Lindon ou je ne sais qui sur un avocat du XVIe qui trompe sa bourgeoise. J'ai vécu de très grands moments dans les salles obscures.
J'ai écouté des tonnes de disques aussi. J'insiste : des disques bordel, pas des mp3 merdiques. Là, plus encore que le cinéma, certains me possèdent. Le dernier en date : Spiritualized, évidemment. Impossible de me l'enlever du crâne. Mais contrairement au cinéma, la décennie musicale est plus vague pour moi. J'ai du mal d'ailleurs à me rappeler des années de sortie.
Songs for the deaf ? Si je ne jette pas un oeil sur le boitier, je ne saurais pas dire en quelle année il est sorti. Plutôt au début de la décennie, non ? J'ai beau essayer, je suis dans le brouillard. Je ne vois pas de nouveaux courants imposant de nouvelles donnes, ce qui ne veut pas dire qu'aucun grand disque n'est sorti. Pendant ces dix dernières années, je me suis ouvert à tout un pan de musique que je ne connaissais pas : une musique américaine, plus violente, plus sombre alors que j'écoutais des trucs plus anglais auparavant. Et puis j'ai remonté le fil du temps, je me suis pris en pleine tronche Dylan, Mozart, Puccini, Bach, Miles Davis - les cyniques diront que ce sont des goûts très polissés, très convenus, ce qui n'est pas faux. C'est convenu, mais il y a une raison à cela : ce sont des grands, qu'on peut écouter indéfiniment. Ils durent. Pas certains que la majeure partie des autres puisse en dire autant. Tout de même, j'ai toujours essayé de garder une oreille collée aux rails, histoire de. J'ai sué dans le désert stoner en balançant la tête, j'ai halluciné en écoutant et en allant voir 31 knots, un groupe qui propose quelque chose, qui cherche et trouve souvent un langage n'appartenant qu'à lui. Les relectures des musiques marquantes (les Strokes étant le point de départ de toute cette tendance) ont laissé apparaître de grands groupes, souvent en Black (Angels, Mountain, Keys) et des groupes ridicules ou anecdotiques. Des gens incapables de s'exprimer honnêtement, obsédés par leur image, des poseurs ineptes.
Et puis durant ces dix ans j'ai vu pas mal de concerts, arpenté la meute des indés qui n'ont jamais manqué de me faire rire. Je me souviens que, dans les premiers concerts à Paris, alors que j'étais excité comme une puce d'enfin toucher du doigt ce que je désirais tant, la plupart des gens dans le public avait l'air blasé, ennuyé, agacé même et ce avant que le concert ait débuté. Ca m'avait paru étrange. La pose intellectuelle qui consiste à ne s'enthousiasmer pour rien m'a toujours affligé. C'est juste un comportement par défaut. Le cynisme a envahit tout. Si on s'enflamme pour un groupe (à tort ou à raison), on vous regarde comme si vous débarquiez de Mars. Désôlé si je ressens encore des choses. C'est possible de simplement ressentir encore ? De l'autre côté du spectre indé, mes dix ans de concert m'ont fait découvrir les décérébrés, pauvres cons et connes amoureux d'une image (qu'ils n'ont pas inventée, qu'ils croient leur, et qui change au gré du temps qu'il fait, un coup Strokes, un coup new wave et blabla). Des jeunes gens persuadé qu'ils écoutent la meilleure musique du monde, alors qu'ils ont dix disques, un disque dur de 250 go de musique qu'ils n'écouteront jamais mais c'est beau tous ses fichiers dans l'ordinateur - et bien sûr ils écoutent les deux ou trois titres qu'ils adoooorent en boucle et en mp3 sur des enceintes d'ordinateur de merde. Allez, vous les connaissez, ils ont adoré la musique de la pub pour Apple, et ils trouvent que MGMT c'est géniaaaal, sans parler de XX, quels génies ! Bref. Heureusement, j'ai aussi croisé des gens passionnés, ils se tiennent souvent un peu à l'écart, ferment les yeux, et écoutent un concert plus qu'ils ne le regardent.
...
La dématérialisation de la musique est symptomatique de notre époque qui nous a fait croire qu'il n'y avait plus d'usines, plus d'ouvriers, plus de mains et de bras, en fait. La musique a subit ça aussi de plein fouet. Les instruments ont disparu des écrans de télé, ça ne date pas d'hier. Et maintenant c'est le support disque qui va disparaître. Merde. Crumb, un vieux con réactionnaire que j'adore, expliquait que le rituel de changer de face un disque le comblait. Dix ans ont passé pendant lesquels tout le monde s'est préparé à ça. Fin des disquaires, fin du support, gratuité. Le support cadrait les oeuvres : fallait sortir un album (9 à 12 morceaux, pourquoi pas un double...) pondre un truc homogène, pensé, ou au contraire un patchwork délirant, mais tout était ramené aux 70 minutes et quelques du contenant. Et il fallait payer, ce qui est la moindre des choses. Et les mecs qui tenaient en main l'exemplaire de leur premier disque connaissait un truc intense indescriptible. Est-ce que la dématérialisation signera aussi la fin du format album ? Et au profit de quelles formes ? Marrant que plutôt que de réfléchir à ces questions les Lips préfèrent balancer
Embryonic un double album achetable chez des disquaires, une oeuvre homogène et longue, alors qu'ils auraient pu la saucissonner en 4 titres téléchargeables. Les derniers des Mohicans avec panache.
...
Le plus marquant dans cette décennie me paraît être l'incroyable qualité atteinte par certaines séries.
Les Soprano et
Six feet under en tête. Profondeur psychologique, intelligence du propos, acteurs incroyables... l'intime décortiqué, mais pas le trivial ou le graveleux, juste l'intime. Un peu comme au cinéma, d'ailleurs, ou même les super-héros ont dû se dépêtrer avec la vie, comme tout un chacun. Le plus génial dans tout ça, c'est que jamais ce n'est tombé dans le psychologisant. Et que, souvent, ces séries étaient drôles.
...
Bon, j'ai bien conscience que tout ça est très épars, mais comme je l'ai déjà écrit, je suis incapable de faire des listes ou des bilans. Et essayer de citer tout ce qui m'a marqué pendant ces dix dernières années ressemblerait plus à une interminable liste sans queue ni tête. Quoi qu'il en soit, une nouvelle décade se pointe, et je ne sais foutrement pas ce qu'elle nous réserve. Je sais seulement que je continuerai à acheter des disques tant que des gens en feront et que d'autres en vendront. J'éviterai le plus possible les festivals, je me tiendrai éloigné aussi des hypes diverses et des polémiques stériles, ce qui maintiendra ce blog à 10 visiteurs. Et ça sera pas plus mal...
Ce blog, tiens. Il n'est pas mort, même s'il n'est plus tout à fait vivant non plus. Quelques "disques qui changent la vie" devraient arriver (Lift to experience, Chet Baker, Vincent Gallo, entre autres...) et puis... qui sait, on verra bien. D'ici là, bon vent à tous.